Qu'est-ce que le "petit véhicule" ?...
L’opposition entre un « Petit » et un « Grand » « Véhicules » est extrêmement courante dans le bouddhisme, aujourd’hui, tant en Asie qu’en Occident. Très souvent, on utilise aussi l’expression de « Petit Véhicule » pour désigner l’école Theravâda, la plus ancienne des écoles bouddhistes actuelles, présente dans toute l’Asie du sud-est, alors que les écoles qui se sont implantées et développées dans le reste de l’Asie (Extrême-orient, Himalaya ou Asie centrale) se réclament, elles, du « Grand Véhicule ».
L’emploi de l’expression « Grand Véhicule » ne pose a priori aucun problème, mais il n’en va pas de même pour celui de « Petit Véhicule », qui se révèle nettement péjoratif. De plus, malgré certaines permanences, la définition qui en a été donnée a varié au cours des siècles et s’est différenciée dans ses emplois, notamment entre l’Extrême-Orient et l’aire tibétaine. Elle masque aussi, en partie, des réalités historiques dont on a souvent sous-estimé l’importance et la valeur - et les chercheurs occidentaux, dans ce domaine, ne sont pas exempts d’une certaine responsabilité…
Les emplois actuels de l’expression de « Petit Véhicule » relèvent en fait d’une grande confusion, qui mêle des définitions et des usages d’époques et de lieux différents, et procède à des assimilations souvent tout à fait surprenantes. Une approche historique et systématique devrait permettre de lever certaines des ambiguïtés les plus flagrantes et de débrouiller l’écheveau des significations comme des emplois les plus abusifs. C’est ce que cet article se propose de tenter...
Pour en finir avec le "petit véhicule"...
par Dominique Trotignon, Directeur de l'UBE
Le terme "yâna" dans le canon ancien
Le terme yâna apparaît peu dans le canon ancien et il est généralement employé dans son sens matériel de « char », « chariot », « voiture » : quand le jeune prince Siddharta sort de son palais et effectue les « Quatre rencontres » qui vont décider de sa carrière spirituelle, c’est en yâna – en char – qu’il se déplace, en compagnie de son cocher.
Yâna apparaît cependant, quoique rarement, dans le sens de « enseignement du Bouddha », selon une image traditionnelle en Inde qui compare les maîtres spirituels à des « passeurs de gué », des « conducteurs », faisant passer les êtres, grâce à un radeau ou un autre quelconque « véhicule », au-delà du « fleuve » du samsâra (le cycle des naissances et des morts) jusqu’à « l’autre rive » bienheureuse du nirvâna.
Il se présente alors sous la forme de « eka-yâna » (unique, eka, véhicule, yâna) afin de signifier que l'enseignement du Bouddha est le seul capable de mener réellement au-delà du samsâra, par opposition à l’enseignement des autres maîtres spirituels qui, eux, ne sont pas efficaces en cette matière.
Dans cette littérature ancienne, il n’est jamais question d’opposer un « petit » et un « grand » véhicule. Pourtant, les écoles anciennes vont distinguer trois voies d’accès menant à l’Eveil, à la bodhi : celle des « Auditeurs » ou sâvaka (sk. srâvaka), celle des « buddha-par-eux-mêmes » ou pacceka-buddha (sk. pratyeka-buddha) et celle des « Etres d’Eveil » ou bodhisatta (sk. bodhisattva), cette dernière étant la seule qui mène à l’Eveil des « Eveillés parfaitement accomplis » (sammasam-buddha ; sk. samyaksam- buddha). Cependant, les trois termes ici associés à bodhi n’ont pas leur correspondant avec le terme yâna. On ne parle pas encore d’un « Véhicule des bodhisattva » ou d’un « Véhicule des buddha-par-eux-mêmes »…
En effet, par définition, la voie qui mène à la pacceka-bodhi ne saurait s’enseigner car elle constitue l’aboutissement d’un cheminement solitaire, dans une période où aucun enseignement du Dharma n’est accessible. Aucune école bouddhiste ne peut donc enseigner ou transmettre une telle voie, un tel yâna. De la même manière, un bodhisatta, futur sammasam-buddha, chemine lui aussi dans la solitude, renonçant même à mettre en pratique l’enseignement des buddha qu’il peut rencontrer au cours de ses nombreuses vies successives, car il se doit de retrouver le chemin qui mène au plein Eveil par ses propres efforts, sans aide et sans guide, par sa propre pratique solitaire des « vertus » ou pârami (sk. pâramitâ).
Pour le bouddhisme ancien, un seul yâna est enseignable : l’eka-yâna qu’entendent les Auditeurs (sâvaka). Un seul buddha est capable de l’enseigner : le sammasam-buddha. Le paccekka-buddha, quant à lui, reste silencieux et ne reçoit aucun enseignement. Et les sâvaka-buddha ne font que transmettre et « répéter » l’enseignement parfait d’un sammasam-buddha.
Et s'il existait plusieurs "yâna" ?...
A peine un siècle après la disparition du Bouddha, ses disciples s’interrogèrent sur la manière exacte dont celui-ci était parvenu à l’Eveil : quel avait été son cheminement de bodhisattva (« être promis à l’Eveil »), au cours de ses nombreuses vies antérieures ? Surtout : avait-il cheminé seul, sans recevoir d’enseignement et en découvrant par lui-même ce qu’il avait ensuite transmis à ses disciples ou, au contraire, avait-il été auditeur de l’enseignement de Bouddhas plus anciens, rencontrés au cours de sa « carrière de bodhisattva » ?
Sur ce point, les textes n’étaient pas très clairs... Les plus nombreux affirmaient qu’il avait cheminé seul - et ce parcours solitaire, extraordinaire, expliquait ses capacités insignes d’enseignant. Mais deux ou trois textes, qui figuraient aussi dans le canon conservé pieusement par la Communauté, affirmaient qu’il avait rencontré des Bouddhas du temps passé qui l’avaient enseigné... Objectivement, rien ne permettait de trancher en faveur de l’une ou de l’autre version, il s’agissait de choisir en fonction de son « intime conviction » ! La communauté se sépara en deux courants distincts...
Pour les uns, il n’existait qu’un seul enseignement possible : celui que le Bouddha, après son parcours solitaire, avait transmis à ses « auditeurs » (sravâka) et qui proposait de suivre une voie monastique, celle des « Anciens » (Sthavira en sanskrit ; le terme « Ancien » désigne un grade monastique correspondant à dix ans d’ordination). Ce courant fut donc appelé la « Voie des Anciens » (Sthavira-vâda). Pour les autres, il existait plusieurs enseignements, non seulement celui délivré aux futurs moines, mais aussi celui que le Bouddha avait reçu de ses prédécesseurs, réservé à ceux qui s’engageaient, comme lui, sur la « Voie des bodhisattva ». Ceux-là, qui se trouvèrent en majorité, s’appelèrent la « Grande Assemblée » (Mahâ-samghîka).
Sans qu’on sache exactement comment cette idée s’est répandue, on constate qu’elle connut un succès certain car on la retrouve à l’origine même des sûtra dits du « Grand Véhicule » (mahâ-yâna).
En effet, les plus anciens textes qui se présentent sous cette appellation - le « Sûtra de la pousse de riz » ou les sûtra de la « Perfection de Sagesse » (prajñâpâramitâ-sûtra) - mettent en scène des bodhisattva recevant un enseignement du Bouddha Sâkyamuni ou en délivrant un eux-mêmes à l’intention de ses disciples, situation qui ne se rencontre jamais dans les textes du canon ancien. Du coup, la voie du bodhisattva est présentée comme une voie, un enseignement, un yâna qui peuvent, eux aussi, s’enseigner et se transmettre.
Les disciples du Bouddha auraient dès lors deux possibilités : soit continuer de s’engager dans la Voie des Auditeurs, soit choisir de suivre la voie du bodhisattva, beaucoup plus difficile mais aussi beaucoup plus « intéressante » pour le salut de tous les êtres.
Cette controverse met en évidence un changement de paradigme important.
A époque ancienne, c’est le Bouddha après son Eveil qui constitue l’unique modèle à suivre ; il est l’exemple même du bhikshu, le renonçant « sans foyer » qui pratique la discipline (vinaya) et le développement mental (bhavana), notamment l’attention, et ce bien qu’il ait déjà atteint l’Eveil ; il exprime sa compassion en délivrant son propre enseignement et par l’exemplarité de son mode de vie de bhikshu.
Or, au fil des siècles, on valorisera de plus en plus le bodhisattva, dans son cheminement avant l’Eveil. Celui-ci est souvent présenté comme un « maître de maison », engagé dans la vie sociale, œuvrant au bien d’autrui en même temps qu’il travaille à sa propre libération.
L’opposition entre un « Petit » et un « Grand » « Véhicules » est extrêmement courante dans le bouddhisme, aujourd’hui, tant en Asie qu’en Occident. Très souvent, on utilise aussi l’expression de « Petit Véhicule » pour désigner l’école Theravâda, la plus ancienne des écoles bouddhistes actuelles, présente dans toute l’Asie du sud-est, alors que les écoles qui se sont implantées et développées dans le reste de l’Asie (Extrême-orient, Himalaya ou Asie centrale) se réclament, elles, du « Grand Véhicule ».
L’emploi de l’expression « Grand Véhicule » ne pose a priori aucun problème, mais il n’en va pas de même pour celui de « Petit Véhicule », qui se révèle nettement péjoratif. De plus, malgré certaines permanences, la définition qui en a été donnée a varié au cours des siècles et s’est différenciée dans ses emplois, notamment entre l’Extrême-Orient et l’aire tibétaine. Elle masque aussi, en partie, des réalités historiques dont on a souvent sous-estimé l’importance et la valeur - et les chercheurs occidentaux, dans ce domaine, ne sont pas exempts d’une certaine responsabilité…
Les emplois actuels de l’expression de « Petit Véhicule » relèvent en fait d’une grande confusion, qui mêle des définitions et des usages d’époques et de lieux différents, et procède à des assimilations souvent tout à fait surprenantes. Une approche historique et systématique devrait permettre de lever certaines des ambiguïtés les plus flagrantes et de débrouiller l’écheveau des significations comme des emplois les plus abusifs. C’est ce que cet article se propose de tenter...
Pour en finir avec le "petit véhicule"...
par Dominique Trotignon, Directeur de l'UBE
Le terme "yâna" dans le canon ancien
Le terme yâna apparaît peu dans le canon ancien et il est généralement employé dans son sens matériel de « char », « chariot », « voiture » : quand le jeune prince Siddharta sort de son palais et effectue les « Quatre rencontres » qui vont décider de sa carrière spirituelle, c’est en yâna – en char – qu’il se déplace, en compagnie de son cocher.
Yâna apparaît cependant, quoique rarement, dans le sens de « enseignement du Bouddha », selon une image traditionnelle en Inde qui compare les maîtres spirituels à des « passeurs de gué », des « conducteurs », faisant passer les êtres, grâce à un radeau ou un autre quelconque « véhicule », au-delà du « fleuve » du samsâra (le cycle des naissances et des morts) jusqu’à « l’autre rive » bienheureuse du nirvâna.
Il se présente alors sous la forme de « eka-yâna » (unique, eka, véhicule, yâna) afin de signifier que l'enseignement du Bouddha est le seul capable de mener réellement au-delà du samsâra, par opposition à l’enseignement des autres maîtres spirituels qui, eux, ne sont pas efficaces en cette matière.
Dans cette littérature ancienne, il n’est jamais question d’opposer un « petit » et un « grand » véhicule. Pourtant, les écoles anciennes vont distinguer trois voies d’accès menant à l’Eveil, à la bodhi : celle des « Auditeurs » ou sâvaka (sk. srâvaka), celle des « buddha-par-eux-mêmes » ou pacceka-buddha (sk. pratyeka-buddha) et celle des « Etres d’Eveil » ou bodhisatta (sk. bodhisattva), cette dernière étant la seule qui mène à l’Eveil des « Eveillés parfaitement accomplis » (sammasam-buddha ; sk. samyaksam- buddha). Cependant, les trois termes ici associés à bodhi n’ont pas leur correspondant avec le terme yâna. On ne parle pas encore d’un « Véhicule des bodhisattva » ou d’un « Véhicule des buddha-par-eux-mêmes »…
En effet, par définition, la voie qui mène à la pacceka-bodhi ne saurait s’enseigner car elle constitue l’aboutissement d’un cheminement solitaire, dans une période où aucun enseignement du Dharma n’est accessible. Aucune école bouddhiste ne peut donc enseigner ou transmettre une telle voie, un tel yâna. De la même manière, un bodhisatta, futur sammasam-buddha, chemine lui aussi dans la solitude, renonçant même à mettre en pratique l’enseignement des buddha qu’il peut rencontrer au cours de ses nombreuses vies successives, car il se doit de retrouver le chemin qui mène au plein Eveil par ses propres efforts, sans aide et sans guide, par sa propre pratique solitaire des « vertus » ou pârami (sk. pâramitâ).
Pour le bouddhisme ancien, un seul yâna est enseignable : l’eka-yâna qu’entendent les Auditeurs (sâvaka). Un seul buddha est capable de l’enseigner : le sammasam-buddha. Le paccekka-buddha, quant à lui, reste silencieux et ne reçoit aucun enseignement. Et les sâvaka-buddha ne font que transmettre et « répéter » l’enseignement parfait d’un sammasam-buddha.
Et s'il existait plusieurs "yâna" ?...
A peine un siècle après la disparition du Bouddha, ses disciples s’interrogèrent sur la manière exacte dont celui-ci était parvenu à l’Eveil : quel avait été son cheminement de bodhisattva (« être promis à l’Eveil »), au cours de ses nombreuses vies antérieures ? Surtout : avait-il cheminé seul, sans recevoir d’enseignement et en découvrant par lui-même ce qu’il avait ensuite transmis à ses disciples ou, au contraire, avait-il été auditeur de l’enseignement de Bouddhas plus anciens, rencontrés au cours de sa « carrière de bodhisattva » ?
Sur ce point, les textes n’étaient pas très clairs... Les plus nombreux affirmaient qu’il avait cheminé seul - et ce parcours solitaire, extraordinaire, expliquait ses capacités insignes d’enseignant. Mais deux ou trois textes, qui figuraient aussi dans le canon conservé pieusement par la Communauté, affirmaient qu’il avait rencontré des Bouddhas du temps passé qui l’avaient enseigné... Objectivement, rien ne permettait de trancher en faveur de l’une ou de l’autre version, il s’agissait de choisir en fonction de son « intime conviction » ! La communauté se sépara en deux courants distincts...
Pour les uns, il n’existait qu’un seul enseignement possible : celui que le Bouddha, après son parcours solitaire, avait transmis à ses « auditeurs » (sravâka) et qui proposait de suivre une voie monastique, celle des « Anciens » (Sthavira en sanskrit ; le terme « Ancien » désigne un grade monastique correspondant à dix ans d’ordination). Ce courant fut donc appelé la « Voie des Anciens » (Sthavira-vâda). Pour les autres, il existait plusieurs enseignements, non seulement celui délivré aux futurs moines, mais aussi celui que le Bouddha avait reçu de ses prédécesseurs, réservé à ceux qui s’engageaient, comme lui, sur la « Voie des bodhisattva ». Ceux-là, qui se trouvèrent en majorité, s’appelèrent la « Grande Assemblée » (Mahâ-samghîka).
Sans qu’on sache exactement comment cette idée s’est répandue, on constate qu’elle connut un succès certain car on la retrouve à l’origine même des sûtra dits du « Grand Véhicule » (mahâ-yâna).
En effet, les plus anciens textes qui se présentent sous cette appellation - le « Sûtra de la pousse de riz » ou les sûtra de la « Perfection de Sagesse » (prajñâpâramitâ-sûtra) - mettent en scène des bodhisattva recevant un enseignement du Bouddha Sâkyamuni ou en délivrant un eux-mêmes à l’intention de ses disciples, situation qui ne se rencontre jamais dans les textes du canon ancien. Du coup, la voie du bodhisattva est présentée comme une voie, un enseignement, un yâna qui peuvent, eux aussi, s’enseigner et se transmettre.
Les disciples du Bouddha auraient dès lors deux possibilités : soit continuer de s’engager dans la Voie des Auditeurs, soit choisir de suivre la voie du bodhisattva, beaucoup plus difficile mais aussi beaucoup plus « intéressante » pour le salut de tous les êtres.
Cette controverse met en évidence un changement de paradigme important.
A époque ancienne, c’est le Bouddha après son Eveil qui constitue l’unique modèle à suivre ; il est l’exemple même du bhikshu, le renonçant « sans foyer » qui pratique la discipline (vinaya) et le développement mental (bhavana), notamment l’attention, et ce bien qu’il ait déjà atteint l’Eveil ; il exprime sa compassion en délivrant son propre enseignement et par l’exemplarité de son mode de vie de bhikshu.
Or, au fil des siècles, on valorisera de plus en plus le bodhisattva, dans son cheminement avant l’Eveil. Celui-ci est souvent présenté comme un « maître de maison », engagé dans la vie sociale, œuvrant au bien d’autrui en même temps qu’il travaille à sa propre libération.
Dernière édition par Jean-Shérab le Sam 08 Nov 2008, 12:15, édité 1 fois










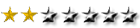
 Astrologie chinoise
Astrologie chinoise Théorie de l'esprit
Théorie de l'esprit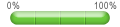


» Jour de ROUE important dans le calendrier Bouddhiste
» Trois livres de David Michie
» Les différentes approches du Mahamudra
» Bonjour à tous les membres et merci de m'accueillir !
» Bizarre, apaisant et Respiration assoiffée
» L'utilisation de l'encens pour les morts
» Bonjour à tous - Merci pour l'accueil
» 4 documentaires sur le bouddhisme : Sri Lanka, Tibet, Kalou Rimpoché, Bouthan
» Prise de refuge à Beaumont
» Bonjour a tous, sous un grand chêne, en creuse
» Présentation Jonathan Carribo., je devais m'inscrire à l'arbre à refuges
» Bonjour à toutes et tous !
» Présentation de Djinn, pratiquant en autonomie du dharma
» Bonjour à tous de la part de Pieru
» Dharma Appliqué: Présentation de la rubrique
» Le maître né du lotus: THE DAKINI CODE
» Michel Collon – Face à Israël : Que pouvez-vous faire ?
» ESSAI La notion de possession
» Déterminisme: Le Choix est-il une illusion ?
» Canon Pali : comment reconnaître une mauvaise personne et une bonne personne au regard de l’orgueil et de l'humilité
» Les problèmes de la méditation de pleine conscience
» Tukdam : méditer jusqu’à la mort
» La petite voix ? ...................
» Bouddhisme : la loi du silence
» On nait mis en boîte ! .....................
» Bouddha n'était pas non violent...
» Le Cercle d'Eveil 2024 Juin
» Amitābha: Le Grand Soutra de la Vie Infinie
» Saga Dawa 2024 ( du 9 mai au 6 juin 2024 )
» Bertrand Piccard, son dernier livre ( 2021 )
» Blessé au visage , un orang-outan se soigne avec un pansement végétal
» Découvrez les Bienfaits du Bouddhisme Tibétain pour une Vie Équilibrée
» Drouptcheu de Keuntchok Tchidu
» Citation de Richard Gere ( Article du journal : AuFéminin )
» Cinquantenaire de la fondation de Palden Shangpa La Boulaye
» Bonne Nouvelle chrétienne et Bonne Nouvelle bouddhiste
» Qu’entend-on vraiment par « tout vient de l’esprit » ?
» Bouddhisme vajrayāna : Instructions sur le Mahāmudrā
» Méditation : Qu'est ce que l'esprit sans réfèrence ?
» Des arbres , pour l'Arbre .
» Lankavatara Sutra ----------------------------------------------------
» Mauvaise compréhension - besoin d'explication
» Le Discours entre un Roi et un Moine : Les Questions de Milinda
» Le Bonheur est déjà là , par Gyalwang Drukpa Rimpoché
» Une pratique toute simple : visualisez que tout le monde est guéri ....
» Drapeaux de prière - l'aspiration à un bien-être universel
» Initiations par H.E. Ling Rimpoché
» Bonne année Dragon de Bois à toutes et à tous
» Bouddhisme/-Science de l'esprit : Identité et non-identité
» Déclaration commune concernant la réincarnation de Kunzig Shamar Rinpoché
» Les souhaits de Maitreya , par le 12e Kenting Taï Situ Rimpoché
» L'Interdépendance selon les enseignements du Lamrim
» Qu'est-ce que l'essence de la voie du Dharma ?
» Quelles sont les règles respectées dans les temples bouddhistes tibétain
» Toute l'équipe de L'Arbre des Refuges vous souhaite ses Meilleurs Voeux pour 2024!
» Le Singe
» Le Buffle
» Le Tigre
» Le Lapin (ou Chat)
» Le Coq
» La Chèvre (ou Mouton)
» Le Dragon
» Le Serpent
» Le Cochon
» L'année du Dragon de bois 2024
» Le Cheval
» Le Chien
» Le Rat
» L'Eco Dharma .................................................
» Shantideva: Bodhicaryâvatâra
» J'irai dormir chez vous (émission TV)
» Le Bonheur National Brut
» Le champ d'application ...................................
» Les Quatre Nobles Vérités -------------------------------------